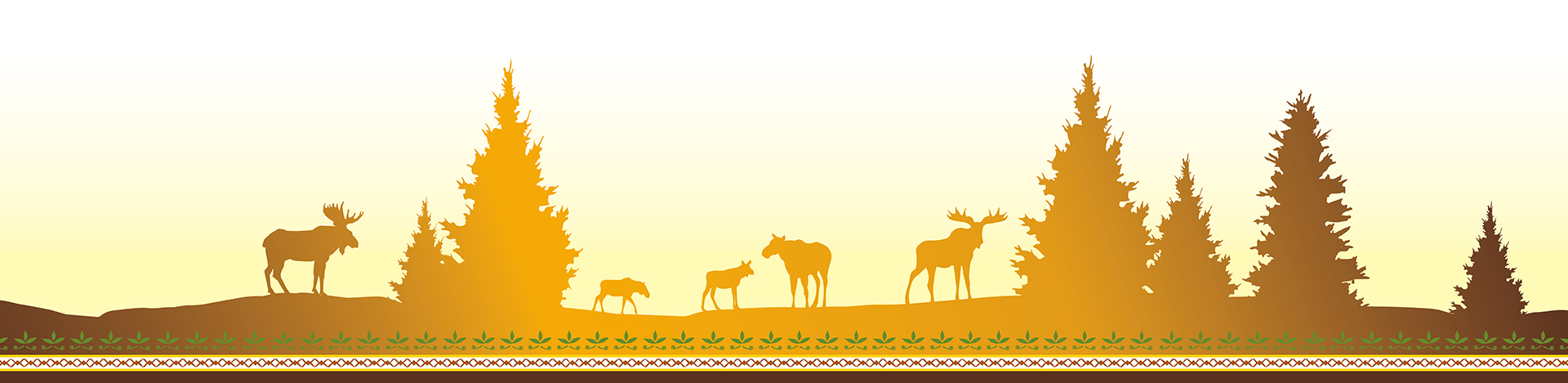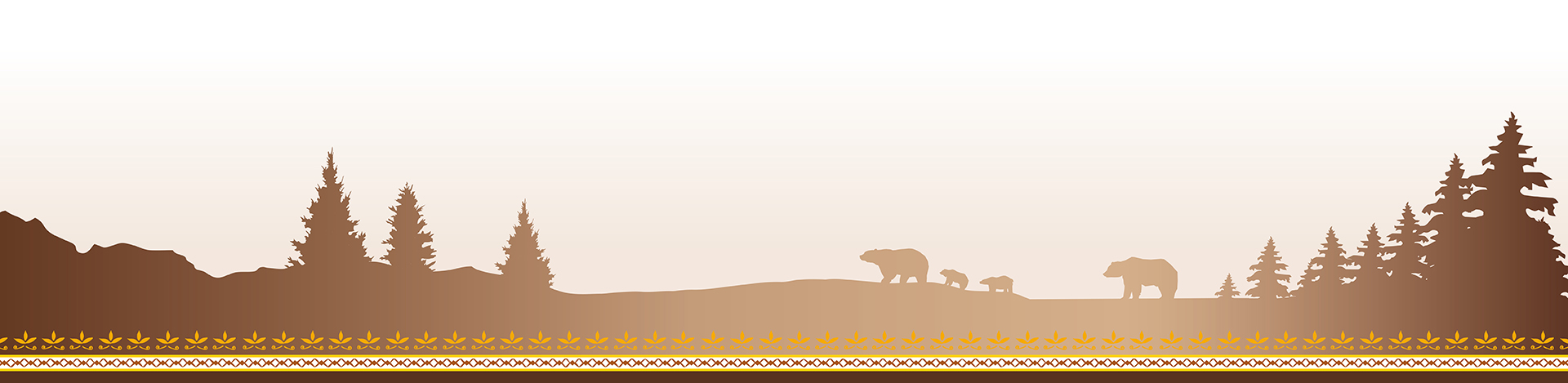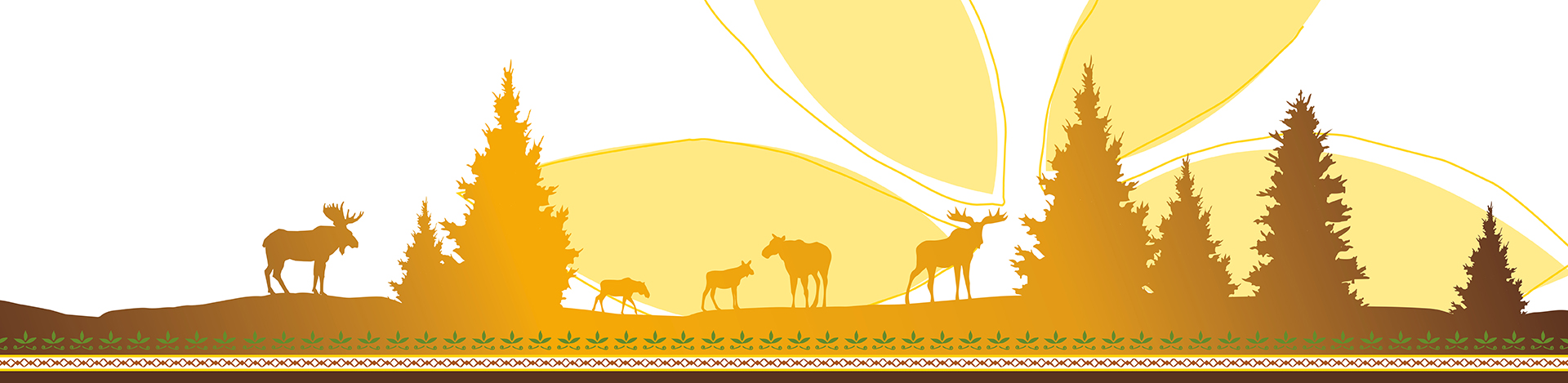Lexique

|
AADI Une aire d’aménagement et de développement innu est un territoire de développement dont la superficie et les ressources permettent de supporter, de manière durable, des activités diversifiées et productives telles la pêche et la chasse en pourvoirie, la foresterie, la cueillette, etc; cet espace serait placé sous la responsabilité d’un gouvernement innu et pourrait faire l’objet d’une convention de gestion spécifique. Nous ne serions pas propriétaires de l’AADI, mais plutôt gestionnaires de cet espace que nous pourrions alors aménager selon des méthodes et des principes qui nous ressemblent. |

|
Comités de liaison sectoriels permanents Dès la signature du traité, un comité de liaison sera institué pour chacun des domaines de compétence fédérale et provinciale. Ce seront des lieux privilégiés pour toutes discussions visant à assurer la participation des parties aux processus prévus, ainsi que le partage des données requises. On pourra y étudier tout sujet particulier sur recommandation de l’une ou l’autre des parties, et procéder au règlement des différends. |

|
Conseil tribal Mamuitun mak Nutakuan Les Premières Nations de Mashteuiatsh et d'Essipit font partie du Conseil tribal Mamuitun mak Nutakuan, à qui elles ont confié le mandat de mener la négociation d'un traité avec les gouvernements du Québec et du Canada. La Première Nation de Nutakuan s'est jointe aux Premières Nations de Mamuitun dans cette négociation en novembre 2000 et celle de Pessamit s’en est retirée en 2005. |

|
Droits ancestraux De manière générale, un droit ancestral est une activité qui consiste en un élément d’une coutume, d’une pratique ou d’une tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive d’une communauté autochtone avant l’arrivée des Européens et qui perdure. Les droits ancestraux se rattachent donc à des activités qui sont en relation avec le mode de vie des autochtones. |

|
Entente de principe L’Entente de principe d’ordre général (EPOG) signée en mars 2004 par les représentants des gouvernements du Canada et du Québec ainsi que par les chefs des Premières Nations de Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit et Nutashkuan, comporte un préambule et dix-neuf chapitres dont les plus importants concernent la portée légale du traité à conclure, un régime territorial, les activités Innu Aitun, la gestion du territoire, des ressources naturelles et de l’environnement, l’autonomie gouvernementale, les arrangements financiers et fiscaux et le développement socioéconomique. |

|
Ententes complémentaires Dans le cadre de l’Entente de principe d’ordre général (EPOG), des ententes complémentaires devront intervenir pour les espèces sous régime structuré de gestion de la ressource. Il s’agit d’espèces dites sensibles comme l’orignal, le caribou des bois, le saumon et la ouananiche, le crabe, le homard, la crevette, le pétoncle, la morue, le turbot et d’autres encore. Le statut de ces espèces en regard d’Innu Aitun, devra faire l’objet d’ententes complémentaires avant la signature du traité. Concernant les activités de chasse, de pêche et de piégeage sur nitassinan, mais hors Innu Assi, les ententes complémentaires porteront sur des sujets comme les périodes de chasse ou de pêche et les limites de captures suivant les espèces et les territoires, les méthodes de capture et les pratiques prohibées, l’enregistrement des prises et autres matières semblables. |

|
Innu Aitun Innu Aitun désigne toutes les activités, dans leur manifestation traditionnelle ou contemporaine, rattachées à la culture nationale, aux valeurs fondamentales et au mode de vie traditionnel des Innus associé à l’occupation et l’utilisation du nitassinan et au lien spécial qu’ils possèdent avec la terre. Sont incluses, notamment, toutes les pratiques, coutumes et traditions dont les activités de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette à des fins de subsistance, rituelles ou sociales. |

|
Innu Assi Il s’agit d’un territoire de dimension plus restreinte que le nitassinan, constitué de la réserve actuelle, des terres ajoutées et de quelques sites ayant une valeur patrimoniale importante. Sur Innu Assi, les Innus pourront compter sur leur propre gouvernement et leurs propres lois pour assurer le développement de leur société. |

|
Innu-tshishe-utshimau Il s’agit de l’autorité compétente pour gouverner la Première Nation selon la constitution de celle-ci. On parle donc d’un gouvernement de type « national », et non pas d’une autorité de type municipal ou régional. |

|
Instance de coordination de la participation Dès la signature du traité, une instance de coordination de la participation réelle (ICOP) sera instituée. Elle aura pour mandat principal de faciliter le bon fonctionnement de la participation réelle des premières nations et de leurs membres à la gestion du territoire, de l’environnement et des ressources naturelles convenu au traité et dans les ententes complémentaires. |

|
Loi sur les Indiens La Loi sur les Indiens du Canada, promulguée en 1876, établit les droits des Indiens inscrits ou « statués », ainsi que de leurs bandes. Une partie de cette loi est dédiée à la vie sur les réserves indiennes. |

|
Mesures transitoires Dès la signature de l’entente de principe, les parties pourront prendre des mesures transitoires pour protéger les droits et intérêts visés relativement aux affectations territoriales et les mesures de développement socioéconomiques convenues et pour préparer la mise en vigueur du traité. Ces mesures viseront la prévention contre les cessions de terres, l’attribution de nouveaux droits ou baux, les acquisitions requises ou toutes autres activités nécessaires en vue de la mise en œuvre du traité. L’expression « mesures transitoires » peut également faire référence aux mesures transitoires du régime d’assurance-emploi du Canada, instituées dans certaines régions du pays où le taux de chômage est particulièrement élevé. Ces mesures sont mises en place en attendant un redécoupage des régions administratives censé survenir à tous les 5 ans, et dont l’objectif est de classer dans la catégorie appropriée, les régions dont la situation socioéconomique est semblable. |

|
Nitassinan Historiquement, il s’agit du territoire traditionnel occupé par les Innus dans le Nord-Est de l’Amérique du Nord. Dans le contexte d’un éventuel traité, il s’agit du territoire traditionnel de chaque première nation signataire, où les Innus pourront pratiquer des droits reconnus (chasse, pêche, piégeage) et exercer une participation réelle à la gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Le nitassinan demeurera sous pleine compétence québécoise et les lois actuelles continueront de s’y appliquer. |

|
Parcs innus Ce type de territoire est dédié à la conservation et à la mise en valeur de la culture innue et rencontre les normes usuelles des parcs qui sont les mêmes pour tous les pays du monde, c'est-à-dire l'absence de développement de ressources naturelles de toute nature, l'interdiction de villégiature et la circulation contrôlée. Les parcs innus sont principalement destinés à recevoir des visiteurs et, concernant les installations de grande envergure, seules celles reliées à l'opération du parc pourront y être érigées. Les activités permises seraient similaires à celles qu'on retrouve dans les parcs de par le monde. |

|
Participation réelle Les gouvernements du Canada et du Québec s’engagent à assurer la participation réelle et significative des Innu-tshishe-utshimau dans les processus de décision relatifs à la gestion du territoire, de l’environnement et des ressources naturelles sur nitassinan. Cette participation visant la protection des droits des Innus est fondée sur une approche de gouvernement à gouvernement, devant débuter le plus amont possible desdits processus. |

|
Regroupement Petapan Les Premières Nations de Mashteuiatsh et d'Essipit font partie du Regroupement Petapan (ex Conseil tribal Mamuitun mak Nutashkuan), à qui elles ont confié le mandat de mener la négociation d'un traité avec les gouvernements du Québec et du Canada. La Première Nation de Nutakuan s'est jointe aux Premières Nations de Mamuitun dans cette négociation en novembre 2000 et celle de Pessamit s’en est retirée en 2005. |

|
Réserves de biodiversité Il s’agit d’aires protégées constituées dans le but de favoriser le maintien de la biodiversité en milieu terrestre et plus spécialement de la représentativité des différentes régions naturelles du Québec. Il existe à présent cinq réserves de biodiversité au Québec disposant d'un statut permanent de protection. La principale différence avec les parcs nationaux est qu'il n'y a pas systématiquement d'aménagement ou d'implantation d'infrastructures de services, ni d'activités récréatives ou éducatives d'organisées par le gouvernement. De façon générale, seules les activités industrielles d'exploitation des ressources naturelles sont interdites, alors que l'accès et la circulation y sont libres. Les réserves de biodiversité sont gérées par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. |

|
Réserves fauniques Il s’agit de territoires de chasse et pêche du Québec, administrés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Ces aires de gestion faunique ont pour mission de conserver, mettre en valeur et exploiter la faune ainsi que de permettre la pratique d'activités récréatives. Les réserves fauniques recouvrent 67 000 km² ainsi que 500 km de rivière à saumons. Depuis 1999, la gestion de ces milieux est confiée à la société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ). Il ne s'agit pas de territoires protégés au sens strict, car l'exploitation minière et forestière y sont permises, mais strictement contrôlées. |

|
Sites patrimoniaux Ces sites à caractère patrimonial visent d'abord à permettre aux Innus de se ressourcer sur le territoire dans la tranquillité. Dans le but d'éviter que le Québec puisse porter atteinte unilatéralement à ces sites, il est prévu dans l'Entente de principe d’ordre général (EPOG) que la réglementation du Québec sera adaptée pour protéger leur caractère patrimonial. De plus, cette réglementation devra être convenue avec les Innus et ne pourra être modifiée sans leur consentement. |

|
Titre aborigène Le titre aborigène est le droit au territoire lui-même. Il s’agit du concept se rapprochant le plus du titre de propriété, tel que le conçoivent les sociétés occidentales d’origine européenne. Il comprend le droit d’occuper des terres et d’utiliser les ressources naturelles. |